Dédale, sans image
Sonia Cantalapiedra
Paru dans le la revue NU(e) n°16 sur Ph. Raymond Thimonga et Ph. Renonçay (2001).
« Et c’était maintenant ainsi que lui apparaissait
le monde de dessus terre : comme une forêt sauvage
qu’emplissait la mort. »
L’homme qui vivait sous terre
R.WRIGHT
La mémoire se délite. Toutefois, hors de question de laisser s’effacer les traces de ces yeux-là, éperdument ouverts à d’autres regards qui s’échappent, esquives discrètes d’un mal-être qui se tait. Hors de question de laisser s’effacer les traces de leurs bras écartelés par l’attente d’une improbable étreinte, quand bien même éphémère. Hors de question de laisser s’effacer les traces de tant de souffrances.
Il faut retourner là-bas. Ce n’est pas terminé.
Janvier 1997, début de la préparation du film.
Avril 2000, fin du tournage du film, Dédale.
Silence (son silence)
C’est vrai, les mauvais souvenirs on s’en rappelle pas trop bien, c’est un flash. Je crois que si on s’en rappelait, on resterait paralysé. Si on se rappelait la rage, la galère où on était — je la souhaite vraiment à personne. Pendant 8 mois, une petite année, rien à foutre de la vie. J’étais là, je m’en foutais de ce que je pouvais faire arriver à moi, de ce que je pouvais faire arriver à quelqu’un. Je m’en foutais.
En fait, je dis, c’est un instinct si on s’en fout pas. Tous les jours on va être là, je suis dans la rue, je suis dans la rue,on va pas s’en sortir.
Quand on s’enfonce dans la galère, on la prend comme elle vient la réalité, on la cisaille. Comme avec une paire de ciseaux. On vit, on est là, poum, poum, poum, ce qui arrive, arrive, et ce qui arrivera pas, ça arrivera pas quoi. Et puis voilà, on en a plus rien à foutre, c’est fini. On vit. Enfin, chais pas comment on peut dire ça. Enfin, moi, c’est comme ça que je l’ai vécu, comme ça, rien à foutre. C’est passé !
Maintenant quand j’y pense, j’aime bien analyser les choses, je trouve que l’homme s’habitue à tout, et ça fait peur.
Ça, ça m’a fait flipper… S’habituer… On aurait pu me jurer, j’te jure qu’un homme qui vit ces moments-là dans sa vie, y peut pas les supporter, j’aurais dit oui. Maintenant, je dis non, il supporte tout, tout. L’homme il supporte tout, il traverse le temps comme ça, même si… Silence…
Si l’homme il devait bouffer de la terre, et bien, il est là. Chais pas, il supporte tout. La galère. Il s’adapte à tout.
Je l’écoutais, je le regardais.
Je le filmais. Longuement, des mois durant. Seul, face à la caméra résolument fixe, immobile, comme à distance. Distance qui permettrait à Malik de se préserver, d’avoir le choix de se livrer, plus ou moins, aux souvenirs, aux blessures, aux luttes d’aujourd’hui et d’hier. Distance que j’imposais avec cette aspiration, un peu folle sans doute, d’atteindre un fragment d’intériorité.
J’étais seule derrière — toujours de l’autre côté — forçant l’attention d’un spectateur imaginaire, concerné par la misère, ici, en France, 4e puissance mondiale. Misère qui masque sa désespérance derrière des éclats de voix trop bruyants, parfois agressifs, ou rage qui sourd insidieusement, nous frôle, comme le bruissement d’un souffle ténu.
Quand elle ne nous terrasse pas.
J’arrivai dans le CHRS (Centre d’hébergement et de Réinsertion Sociale) parisien où j’allais filmer en janvier 1997 pour y rencontrer des hommes encore debout, qui se battent après avoir traversé l’horreur. Des hommes jeunes. J’avais alors cette illusion, qu’épaulés par des professionnels, ils parviendraient, dans le déploiement d’une énergie titanesque, à quitter la mal nommée exclusion. Je m’y rendais pour témoigner des processus de réinsertion qui, après la survie dans la rue, l’enserrement de la faim, du froid, de la peur, de l’inexorable errance et du sentiment d’indignité qui les stigmatise, permettaient à ces hommes de trouver leur place. Ou simplement une place.
Un an d’observation. De maraudes de nuits en associations de domiciliations, d’accueils, en centres d’urgences, etc. Mais surtout, ce CHRS parisien où j’étais bénévole grâce à l’appui de son équipe sociale. Immédiatement, je suis touchée par l’énergie et l’implication de l’équipe, son acharnement à vouloir aider des êtres brisés. Cette année-là, je rencontrai les premiers visages de la misère, les tentatives de suicides, les décompensations, la violence, l’extrême solitude, la détresse, l’aide des bénévoles et des travailleurs sociaux comme exutoire à leur propre détresse, la tentation de la supériorité facile, la générosité. Cette solidarité, aussi, entre errants, impossible. Un an de travail d’approche avant de prendre la caméra, délivrée de quelques illusions… et nouvellement émerveillée. Je découvrais une beauté insoupçonnée.
Son regard paraît étrangement fixe derrière l’épaisseur des verres. Nous nous sommes connus au CHU (Centre d’Hébergement d’Urgence), nous avons bavardé, plaisanté avec d’autres, puis, comme incidemment, il a glissé une feuille de papier entre mes doigts, un texte de lui. La détresse d’un enfant prisonnier dans l’obscurité d’un placard. Muet de douleur. Maintenant, je le filme.
J’ai 23 ans, je m’appelle Leo, je suis dans la galère depuis environ 4 ans, là je suis actuellement ici, je dis le nom ou quoi ?…
Mon parcours est tout simple. J’ai quitté le domicile familial en 88, je suis parti en famille d’accueil, suite à un placement judiciaire, on va le dire comme ça… J’ai fait 3 ou 4 familles d’accueil à la suite parce que pour moi aucune famille pouvait remplacer mes parents. Malgré ce qu’il y a eu avant. (Silence.) En 91 on m’a placé en foyer psychothérapeutique parce qu’on me prenait un peu pour un bargeot du fait des fugues que je faisais, du fait de mon manque de communication et de mon blocage un peu psychologique. (Silence.) Je suis resté 2 ans dans ce foyer-là…
Arrivé à mes 18 ans, étant donné qu’il n’y avait pas de prise en charge jeune majeur pour moi, on m’a mis dehors. Normal, a priori c’était normal, dans ma tête ça ne l’était pas. Donc j’ai décidé de faire un devancement d’appel pour partir à l’armée… j’ai vite pété un plomb, je me suis retrouvé en hôpital militaire pour être réformé, on m’a transbahuté dans trois hôpitaux militaires à trois bouts de la France différents. Et puis on m’a réformé en 94. Donc, je me suis retrouvé à la rue…
Puis j’ai pété les plombs, j’ai fait une tentative de suicide et me suis retrouvé en hôpital psychiatrique pendant 4 mois. Je suis sorti de l’hôpital et je me suis re-retrouvé et… (il sourit) là je squattais dans une cave avec tout ce qu’on peut imaginer dans un squatt : le sommier, la couverture sordide et puis les canettes à côté quoi. Mais bon, ça, ça fait partie de l’encadrement d’un SDF et (silence) je suis allé au CCAS de ma ville natale, j’ai rencontré une assistante sociale qui m’a mis dans un centre d’accueil d’urgence où je suis resté un mois parce qu’on avait estimé qu’un mois c’était suffisant à un SDF pour s’en sortir, à savoir trouver un boulot, trouver un appart et puis se réinsérer complètement. Alors, c’est vrai qu’un mois c’est relativement juste. Et au bout de ce mois-là, étant donné que j’avais commencé à mettre des choses en place et que ça n’a pas abouti, y’a pas eu poursuite d’hébergement, donc, encore une fois la rue… y’avait un encadrement relativement bien présent, j’ai fait une cure sur place, dans un CHRS, je voyais un médecin très régulièrement, et puis j’ai commencé à traîner avec des personnes qu’il aurait mieux fallu que j’évite… je dormais dans un parc, dans une petite cabane de bûcheron, et puis ensuite je suis monté sur Versailles… on a monté une association pour SDF. Et ça me plaisait vraiment au sens où j’étais moi-même en galère et puis j’aidais les autres en même temps, le côté intéressant de la chose, il est là. Je suis resté dans cet autre CHRS pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, y’avait le mariage de ma soeur. J’étais invité. Malheureusement, j’y suis allé, et… (silence, il sourit vaguement comme pour chasser son embarras).
Bien souvent, il a fallu arrêter la caméra. Il demandait une pause et je ne pouvais pas filmer les larmes. D’ailleurs, un accord tacite nous liait : ne pas susciter de pitié, d’émotion immédiate. Nous le savions, aujourd’hui il y a surabondance d’images bouleversantes. Elles déferlent en cascade et leur profusion est le signe d’une pensée phagocytée par ces divertissements ordinaires, à sensations fortes, dispensateurs de bonne conscience. De là, le parti pris de Dédale ; ne pas adoucir les contours de l’inacceptable en proscrivant toute esthétisation de la détresse, en refusant de « créer », ou de recréer, l’émotion sous couvert de témoignage. II fallait restituer la douleur, tout en interrogeant les causes de la misère et les souffrances qu’elle engendre, tout en essayant d’entrevoir quelle pouvait être sa fonction sociale. J’abandonnai donc tout effet et toute figure de style propre au langage cinématographique : images et sons demeurent matières rugueuses dont le film conserve l’âpreté. Lors des entretiens, je tentais d’éviter d’induire quoi que ce soit, par respect — tant de la personne filmée que du spectateur — et par souci d’authenticité. Les plans, maintenus dans une durée conséquente, préservent la ligne du discours, ses méandres, ses ellipses, le rythme et le souffle des personnages et des instants filmés. Ils sont le plus souvent fixes, retranscrivant l’affirmation de la subjectivité par le choix d’un point de vue et d’un cadre, puisqu’il ne saurait exister de réalité filmée mais simplement un regard. Ou plutôt deux regards qui se croisent… Chacun est filmé en entretien frontal, à hauteur du regard, sans plongée ni contre-plongée, sans lumière d’appoint. Seul. Sa parole exprime sa singularité au sein d’une organisation sociale qui ne le reconnaît que derrière un sigle imposé : SDF. Ainsi, à mes yeux, se transfigurent-ils en « héros » d’une nouvelle tragédie où les institutions d’aide et de réinsertion deviennent le relais, le « chœur », d’un ordre collectif qui s’égare autant qu’il nous égare…
La rue, elle m’a appris pas mal de choses. Déjà à survivre, parce que c’est vrai, c’est un univers relativement difficile (silence), elle m’a appris à trouver à manger par mes propres moyens, les sorties de resto, de Mac Do, les invendus et compagnies, elle m’a appris à me faire plus confiance à moi, elle m’a appris à partager beaucoup, avec mes collègues de galère, avec tout le monde en fait, elle m’a appris que si on ne donne pas on peut pas recevoir…
Chaque instant Leo défit la mort ; avec ses poings, avec les poèmes qu’il compose, ou avec l’alcool.
Si on boit, quelque part, c’est pour combler un manque, ou pour (silence) mais en aucun cas c’est pour passer le temps, c’est clair, c’est plus pour combler un manque, ou pour… essayer de rétrécir un vide…
Je le questionne:
– Et le manque le plus flagrant qu’on peut ressentir dans la rue ?
– Alors là, je vais pas répondre par ON, je vais répondre par JE.
Le manque qu’on peut le plus ressentir dans la rue, je pense que c’est la solitude. La solitude de savoir que peut-être qu’il y a des personnes qui ont leur foyer, leur famille, des enfants et qui rigolent. Nous aussi on rigole, mais on rigole jaune quelque part, parce qu’on a pas la chaleur familiale, on a pas toujours à manger comme il faudrait et puis (silence) nous on survit. Tandis que eux, ils vivent, entre guillemets… On vit au jour le jour… On a toujours cette obsession, qu’est-ce que je vais faire, où j’en suis, où je vais et qu’est-ce que je vais devenir. Et bon pour un jeune de 23 ans comme moi, je me dis que je vois la trentaine arriver et j’ai encore pas de solution. Et à 40 ans ? Ça va donner quoi ?
Le visage de Léo, dont je m’imprégnais chaque jour davantage, prolongeait le film d’un écho, d’une résonance obsédante, de ce constat que faisait l’Œdipe de Sophocle, devenu aveugle : c’est quand je ne suis plus rien que je deviens un homme. Léo, et les autres, étaient devenus les héros d’une tragédie sans théâtre et sans spectateurs qui se joue dans le vacarme aveugle des cités et derrière les murs des institutions. Comme dans les antiques cérémonies, ces héros-là subissent une destinée — actes et conséquences — dont ils portent la responsabilité aux yeux de la collectivité qui les enferme. Enfermement dans leur condition plutôt qu’exclusion, car l’exclu ne participe pas de la mécanique sociale ; or je comprenais péniblement que ces enfants de la misère assurent une fonction humble, odieuse à notre esprit, mais dont la nécessité (tant sociale, qu’économique et politique) conditionne leur sujétion. L’ordre dans lequel ils s’inscrivent, les dépasse, le sens de leur existence leur échappe, et pourtant ils se battent. Mais, dès que le combat cesse, la mort s’empresse. Aujourd’hui, l’espérance de vie d’un jeune SDF est de 37 ans. Sans doute Léo le pressent-il lorsqu’il interroge son avenir. Et à 40 ans ? Ça va donner quoi ? Ces destinées attisent le doute, la remise en question de la réalité dominante, sans pour autant susciter de réponse satisfaisante. Rien n’est évident tandis que la parole collective se révèle aimablement relayée par la cohorte des travailleurs sociaux.
L’assistante sociale d’un CHRS : …A Paris, il y a du travail, quand on ne trouve pas de travail, il y a deux hypothèses, soit on en cherche pas, soit on en cherche mal !… ce qui est important — et si vous ne vous réappropriez pas ça, c’est cuit — c’est que quand on ne trouve pas de travail, on est aussi responsable de la situation de dépendance, je sais que c’est dur à dire, on est pas dépendant par hasard. Si Marc perd son travail, c’est pas par hasard, si un tel trouve pas de boulot, c’est pas par hasard. J’y crois pas ! C’est pas la réalité, ça non ! C’est votre réalité, c’est ce que vous en faites. C’est… important de faire la différence. Si Marc est mis à la porte, il en sera totalement responsable. Et s’il me dit, j’en suis pas responsable, là, à mon avis, on a peu de chance de l’aider.
Les travailleurs sociaux se trouvent pris dans le tourbillon des institutions et dans le filet de leur tâche à mener. Malgré les obligations de résultats rapides (bien qu’il faille plusieurs années pour surmonter les traumatismes que la rue génère), malgré leurs formations lacunaires, malgré des consignes contradictoires ou aberrantes (faire des économies avec 2002 francs de revenus mensuels (1))… Néanmoins, les travailleurs sociaux demeurent missionnés pour (ré)insérer ceux qui, la plupart du temps, appartiennent dès leur naissance au monde des « parias », ces pauvres que des conditions d’existence trop précaires font parfois chavirer du côté de la survie au jour le jour, vers la non-vie. Plus ou moins conscients des contradictions et des dysfonctionnements tant institutionnels qu’individuels, les travailleurs sociaux se trouvent progressivement relais et porte-parole d’un ordre dont ils tentent d’assumer ou de réparer les failles les plus cruelles, cependant qu’ils le consolident et assurent sa longévité. Ils deviennent ainsi comme la voix du chœur antique, la voix du plus grand nombre. Celle qui met en garde, tente d’endiguer les errances ou les révoltes du héros, mais aussi, paradoxalement, celle qui parfois le soulage… Jusqu’où est-il possible d’aller dans le désir d’aider sans remise en question de l’ordre établi ? Jusqu’où m’était-il possible de filmer ?
Parfois la réalité filmée devenait invraisemblable par la cruauté ou les aberrations mises au jour, tant nos représentations de l’aide sociale et sa pratique concrète discordent. Sans doute la difficulté ou l’incapacité à assumer une réalité inacceptable la rend-elle invraisemblable ? Il a donc fallu supprimer des séquences. Y aurait-il donc un imaginaire du réel, une sorte d’interférence entre le réel et l’imaginaire qui permettrait à celui-ci de remodeler celui-là ? Le film devrait donc prendre en compte cette altération du réel et son interpénétration avec l’imaginaire…
Les gens qui sont dans la rue qui ont 28 ou 30 voire 40 ans, ils se sont fait leur carapace. Comment veux-tu qu’ils aillent vers quelqu’un ? C’est pas possible (silence). S’ils y vont, ils vont recevoir une aide, ils vont tomber dans un CHRS, et puis ils se diront, et bien à la rue, on avait notre liberté…
Lorsque je rencontrai François au centre d’hébergement d’urgence, il avait déjà passé cinq années dans la rue après une enfance dans les foyers de la DASS.
…alors quand on retombe dans un CHRS, faut un règlement, faut ci, faut ça, donc ils acceptent pas forcément cette solution-là. Donc ils retournent où ils étaient avant. C’est dur de faire (silence) d’obliger, parce que moi je dirais que c’est obliger, d’obliger quelqu’un à reprendre un cycle normal alors qu’il a vécu, 10, 15, 20 ans dehors. C’est quand même (silence) c’est vrai, c’est dur. Va faire comprendre à quelqu’un, je te tends la main, viens, je veux te donner ce que tu recherches, c’est pas forcément ça qu’il cherche. Moi j’ai connu des gens, on leur disait, on les forçait presque à aller dans des foyers, pour manger, pour dormir, mais eux, c’est pas ça qu’ils voulaient. Eux, ils veulent de la reconnaissance, être reconnus, reconnus en tant que personne, même si t’es en difficulté… On se protège de, de (silence) ben justement, du regard des gens. On se protège de la façon dont ils pensent, de la façon dont ils nous voient, parce que même si les gens te regardent d’une façon ou d’un mauvais œil, dans leur tête, ils parlent entre eux et nous on s’est forgé une carapace. C’est comme dans une bulle et autour t’es protégé et t’as l’impression que plus rien ne t’atteindra… on a tellement eu des gens qui nous ont sali (silence) par la parole, qu’à force les gens se sont fait une carapace et ça ne nous atteint plus. Ça s’arrête, c’est dur mais c’est comme ça, et les gens avancent comme ça dans la marginalité, c’est pour ça que je te disais que quelqu’un qui est depuis 10 ans dehors, ça ne l’atteint plus. Il te le dira lui-même, il te dira moi (silence) chacun fait sa vie (silence) moi je suis comme ça et à la rigueur ça devient naturel, c’est dur mais c’est…
Peu à peu, son regard s’était noyé dans les molécules. Il a sans doute été l’un de ceux qui exprimait le plus douloureusement la difficulté « d’être » face à la condescendance bienveillante, face au déni d’existence dans l’oppressante attente de résultats à fournir. Tu peux pas savoir comme c’est salissant, répétait sa voix légèrement fléchissante. II me rappelait que, souvent, pour survivre il faut s’infliger un ordre plus dur que celui que l’on subit. Impossible de filmer sans penser aux regards des passants posés sur François, Léo, ou Malik… aux paupières baissées, à la tête qui se détourne légèrement, l’œil fixe, droit et lointain qui ignore celui qu’il frôlerait si… Je voulais forcer ces regards, les obliger à écouter. Les plans sont résolument longs et laissent se dérouler la parole… Une beauté peu à peu imposait la nudité de l’image. Plus tard, la « mise à plat » de la séquence m’a incitée à éviter les raccords de montage, à proscrire toute image contextualisante ou illustrative. Le son, comme un thème en contre-point, évoque l’agressivité de la rue par le passage d’un engin trop bruyant, l’irruption des bruits de couloirs, de TV, d’éclats de voix… qui violent toute intimité, « coupent » la parole, l’étouffent hors du repos inaccessible. Désormais, le film est avant tout l’histoire d’une rencontre entre des jeunes hommes en galère et une femme qui les filme. De cette entente première est né Dédale.
Parfois, j’étais parfaitement incapable de filmer, j’étais submergée.
II a 20 ans, la crudité des néons de la chambre ne parvient pas à durcir ses traits. Pourtant, dans l’obscurité de ses yeux, l’errance continue. Hakim n’a pas voulu évoquer devant la caméra le plus dur dans la rue : ce moment où il a retrouvé son père allongé sur le quai du métro. Ils ont tenté de rester ensemble, puis ont rapidement compris qu’il fallait se séparer pour garder une chance…
– Qu’est-ce que tu as ressenti en premier quand tu t’es retrouvé à la rue ?
– C’est à dire ?… Rien.
– …Peut-être un sentiment de révolte ? Ou au contraire, tu as eu l’impression que c’était normal ?
– Euh… je… bien sûr… euh… bon. On passe cette question ? (Il sourit.)
II est encore là, assis près de la table où quelques livres empruntés à la bibliothèque s’ennuient entre la poussière et les mégots. Hakim évoque son désir de lire. Mais ne lit pas. II n’en a plus la force. Un jour il a quitté le centre. Personne ne l’a revu.
Après deux ans d’approches, de rencontres, je me trouve chaque jour un peu plus démunie, ignorante de tout ce pan de réalité qui est nôtre. Après la colère, le banal sentiment de révolte, se glisse, insidieux et lancinant, le désir de rendre compte de leurs luttes, de leurs combats. Les doutes s’insinuent, grandissent. La quête se poursuit et je ne sais plus rien. Que cette beauté insoupçonnée.
II faudra retourner là-bas.
(1) 2002 francs en 1998 correspondent à 390 euros en 2016.
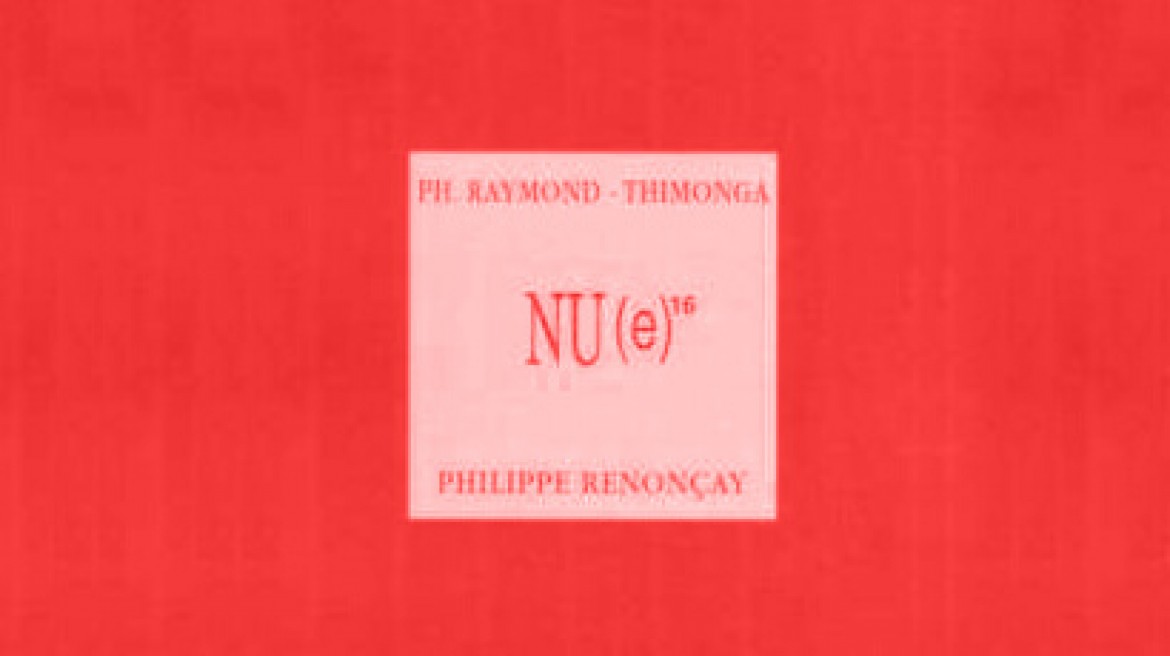
Sorry, the comment form is closed at this time.